Chapitre 9 - Elle et eux
Souvent, nous restions blottis l’un contre l’autre, chez moi, plus rarement chez elle. Et parfois, au cours de notre conversation, je l’entendais me dire :
- Tu vois, Bertrand, ça me rappelle…
Je n’avais alors plus qu’à écouter, et Hélène se mettait à dérouler pour moi un épisode de sa vie.
Bien que de nature pudique, elle s’enhardissait maintenant à se dévoiler de plus en plus, au fil du temps.
Un dimanche après-midi gris et pluvieux, j’étais assis au coin du canapé, appuyé contre l’accoudoir. Hélène, allongée, laissait reposer sa tête sur ma cuisse. D’une main, je lui caressais les cheveux, de l’autre j’effleurais sa cuisse musclée, ce qui, immanquablement, lui donnait la chair de poule. Au hasard de mes pensées, j’évoquai les Landes et l’envie que j’avais de m’y rendre. J’y pensais à cause d’une carte postale qu’un ami m’avait envoyée d’Hossegor.
- J’ai des origines dans cette région, enfin, un peu plus au Sud.
- Je te croyais bretonne…
- Je suis née à Rennes, oui, mais ma mère est alsacienne, et mon père est du Béarn, du côté de Pau.
Les deux guerres avaient décimé la famille maternelle d’Hélène, et c’est le plus souvent dans sa famille paternelle que se passaient les vacances d’été, dans la maison familiale de Saint-Jean de Luz.
Hélène m’expliqua que son grand-père, haut fonctionnaire dans la cité natale d’Henri IV, avait fait construire, dans les années trente, une coquette maison sur un petit terrain situé en front de mer.
La bâtisse offrait, au rez-de-chaussée, outre la cuisine, une spacieuse salle à manger et un salon avec une alcôve servant de bibliothèque. A l’étage, il y avait quatre chambres et un petit cabinet de toilette, luxe rare à l’époque. C’était dans cette demeure qu’Hélène avait entendu de son grand-père, et à maintes reprises, le récit de l’inauguration du musée de la mer de Biarritz, en 1935.
- Il était fier, dit Hélène, d’égrener la liste des personnalités présentes, tandis que lui-même occupait une place de choix, du fait de sa fonction à la Préfecture de Pau.
Et elle continua en me racontant ses souvenirs de vacances mi-béarnaises mi basques. Elle se remémorait plus particulièrement les dimanches de la belle saison.
Après la messe du matin et le traditionnel confit de canard accompagné de pommes de terre sautées et persillées, on sortait dans le jardin pour l’après-midi. C’était le moment où Alfred, le grand-père, sortait son étui de papier Job et prenait une pincée de tabac d’un petit paquet gris, pour rouler tranquillement une cigarette. Marie, sa femme, reprenait un tricot en cours, écharpe multicolore ou pull torsadé.
Quand à Hélène et ses frères et sœurs, ils traversaient bien vite la rue pour aller jouer sur la plage.
Quand les parents d’Hélène étaient présents, les deux premières semaines d’août, la famille partait à bord de la vieille Citroën passer la journée en Espagne, à Ondarroa, un petit village côtier distant d’une centaine de kilomètres, où un discrète plage de sable fin semblait n’attendre qu’eux.
J’étais impressionné par la précision avec laquelle Hélène se souvenait de ces rituels familiaux.
- On déchargeait la malle d’osier du coffre de la voiture et on l’installait à l’ombre de deux parasols rayés jaune et blanc, que mon grand-père plantait dans le sol. Et puis on faisait honneur au pique-nique préparé par ma grand-mère. Il y avait toujours des rillettes de foie de canard faites maison, et puis une bouteille de vin rosé pour les adultes. Il fallait respecter scrupuleusement le temps de la digestion, avant de pouvoir se baigner. Et c’est jusqu’au soir que nous restions jouer dans l’eau, sauter par-dessus les vagues, plonger…
En écoutant Hélène, j’imaginais que les garçons de son âge devaient rôder autour d’elle, quand elle disputait un match de volley, sur la plage. Sa taille élancée l’avantageait, pour les montées au filet. Et les filles devaient être envieuses de sa beauté et de sa peau qui prenait vite une couleur caramel.
Une famille unie, des frères et sœurs avec qui partager complicité et jeux : pour moi, qui était fils unique, c’était un autre monde. Je comprenais qu’Hélène soit nostalgique de ce temps-là.
- C’était le bon temps… Enfin, c’était un autre temps, dit-elle. Tout a bien changé, depuis que grand-papa est mort.
Délicatement, je me levai du canapé en soulevant sa tête de ma cuisse, pour la reposer sur un coussin de coton bleu. De la cuisine, je rapportai un plateau avec du thé au jasmin et deux tartelettes aux fraises, les fruits préférés d’Hélène, achetés le matin-même à la pâtisserie du coin de la rue.
- Excuse-moi, Bertrand, de m’épancher ainsi, toutes ces histoires ne doivent guère t’intéresser.
Elle me paraissait triste et fatiguée, tout-à-coup. Je m’empressai de la rassurer :
- Non, détrompe-toi. Nous avons tous parfois la nostalgie des bons moments du passé. Paradoxalement, cela engendre souvent des moments de cafard, quand on les revit ainsi en pensée.
Devant le regard dubitatif d’Hélène, je lui expliquai ma théorie :
- Pour moi, il y a deux sortes de cafard, l’un naissant quand on est un peu fatigué ou que l’on rencontre des ennuis sérieux, l’autre moins explicable, mais sacrément plus dur. Celui-là vient sans raison apparente, tout simplement parce qu’on a un peu trop tiré sur la corde, et encore… Il frappe d’autant plus fort qu’on se croyait costaud, si tu vois ce que je veux dire…
Je me croyais obligé de conseiller Hélène :
- Je sais que c’est plus facile à dire qu’à faire, mais essaie de ralentir un peu, au niveau de ton travail. Apprends à mieux déléguer. Avec tes collègues, vous formez une équipe. Même si tu est responsable du projet, je n’es pas seule pour élaborer ces nouveaux produits. Ménage-toi.
Hélène allait me répondre, quand la sonnerie du téléphone retentit. Comme beaucoup de gens, j’avais pris l’habitude de laisser mon répondeur branché, même quand j’étais présent. Et c’est ainsi qu’au bout de quelques sonneries, la voix de mon ami Laurent retentit dans l’appartement. Il était à Londres, où il assistait à un congrès médical. Mais la durée de son séjour ne lui permettait pas, même avec le Shuttle, la nouvelle liaison ferroviaire sous la Manche, de faire un saut jusqu’à Paris.
- Il faut qu’on définisse la décoration avec toi, disait-il. Rick te fait toute confiance. Tu lui as beaucoup plu… professionnellement, je veux dire. On a besoin de tes lumières et de tes compétences sur une foule de détails architecturaux et décoratifs.
Entendre la voix de Laurent, alors que j’étais avec Hélène, m’avait cloué sur place. Et avant que j’aie pu décrocher le combiné, Laurent concluait déjà en lançant :
- Gros bisous, mon Le Corbusier adoré.
Il raccrocha sans que j’aie pu faire un geste vers le téléphone.
- Il t’aime beaucoup, ton ami Laurent, dit Hélène.
Bien que m’attendant ce genre de remarque, je ne pus que bafouiller :
- Euh, oui… enfin, je ne sais pas trop.
Je me ressaisis en tentant de faire diversion, maladroitement, sur un ton que je voulais humoristique.
- Le verbe « aimer », en Français, est difficile à interpréter. Bertrand aime bien la mousse au chocolat, Hélène aine bien les fraises. Bertrand aime bien Hélène, et… et ben oui, Laurent aime bien Bertrand. Enfin, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, puisque tout le monde s’aime bien.
- Il y a une différence entre « aimer bien » et « aimer », dit Hélène, l’air songeur.
Je redevins sérieux :
- Tu sais, Laurent et moi, nous avons vécu tellement de choses ensemble ! ça crée des liens indestructibles, un peu comme toi avec tes frères et sœurs, des liens qui résistent au temps et à la distance..
Hélène, me semblait-il, devenait soupçonneuse :
- Tu m’as dit que vous aviez partagé le même appartement, quand vous étiez étudiants ?
- Oui, pendant presque quatre ans. Et avec pas mal de heurts et d’accrochages entre nous.
Je mentais. En fait, la réalité était tout autre. Ce fut quatre années d’un pu bonheur, et le départ de Laurent avait été douloureux pour moi, une véritable déchirure. La plaie avait mis du temps à se cicatriser.
J’aurais dû profiter des questions d’Hélène, qui devenaient plus précises, pour lui dire la vérité. Mais je n’en avais pas la force. Et je ne la sentais pas prête à l’entendre.
Elle poursuivait son inquisition :
- Tu as beaucoup d’amis, dans ton entourage. Mais quand il est question de Laurent, tu as un ton différent, un peu comme quand il s’agit de Loïc, d’ailleurs. Je l’ai remarqué l’autre soir, à Rennes, chez mes parents. Et je crois que tu serais capable de tout laisser tomber, si Laurent t’annonçait au téléphone un ennui, une catastrophe l’atteignant directement. Tu serais capable de filer directement à l’aéroport pour prendre le premier avion en partance pour San Francisco.
Hélène n’avait pas tort. Je ne voyais rien à ajouter. En désespoir de cause, je dis :
- Tout est inconscient, je suppose… enfin, je ne sais pas.
Encore une fois, je laissais planer le doute. Mais comment aller plus avant ?
En dégustant la dernière bouchée de tartelette aux fraises, des images du dernier voyage que j’avais fait en compagnie de Laurent me revinrent à l’esprit.
Il y avait deux ans de cela, peu avant son départ pour les Etats-Unis. Sur un coup de tête, comme d’habitude, nous étions partis. Pour la Grèce, cette fois, Zakynthos, une île peu connue de la mer Ionienne.
C’était la mi-mai. Je revois les rosiers exubérants aux senteurs exaltantes, les jacinthes sauvages, les tapis de violettes, et cette eau couleur émeraude qui effleurait le sable immaculé de ce début de la belle saison. Nous avions repéré une crique de sable fin, où nous allions souvent, enlacés par la taille, en suivant un chemin parfumé, à travers une colline plantée d’oliviers, d’amandiers et de figuiers.
Nous partagions notre temps entre la plage et notre chambre chez l’habitant, dans une modeste maison à toit-terrasse dominant la côte sauvage, où les vagues déferlaient. Depuis l’unique fenêtre de notre chambre, la mer apparaissait sous la forme d’un petit triangle bleu entre deux maisonnettes.
Les journées se déroulaient entre tendresse et douceur, chacun cherchant à faire plaisir à l’autre. Nos seules sorties, à part la plage, nous menaient sur la place du village, dans une taverne que nous appelions notre cantine. Nous y prenions tous nos repas. Après un ouzo rafraîchissant, parfois offert par le patron, nous choisissions notre menu en soulevant les lourds couvercles des marmites. Aux tables voisines, les habitués buvaient à petites gorgées le café lourd de marc et de sucre.
Les paysages de Zakynthos nous envoûtaient. Ils étaient comme irréels, surgis d’un autre monde, un monde de quiétude, de douceur, de bien-être intemporel. Si des impératifs ne nous appelaient pas en France, nous serions restés des semaines sur cette île. En cas quatre jours, nous n’avons vu de la Grèce que le Parthénon d’Athènes, en une visite éclair, avant de prendre l’avion du retour.
Ma tartelette aux fraises terminée, je continuais à lécher ma fourchette à gâteau, d’où le goût sucré avait depuis longtemps disparu.
Hélène me regardait.
- A quoi tu penses ?
- Oh, à rien…
J’avais sursauté. Je m’en voulais de m’être fait piéger par la nostalgie.
En fait, mes sentiments pour Hélène se contrariaient. Tout s’était déroulé si vite, depuis notre première rencontre. C’était comme si j’étais pris dans le tourbillon sans fin d’un cyclone.
Tout avait basculé si vite, sans que j’aie le temps de réfléchir. Pour la première fois de ma vie, j’étais amoureux d’une fille, mais sans que le désir de mon corps suive celui de mon cœur. Etait-ce le même amour que celui que j’avais éprouvé auparavant pour Laurent, et que j’éprouvais à présent pour Loïc ? Au fond de moi, le doute subsistait.
Y aurait-il deux sortes d’amour, l’amour pour les garçons, et l’amour pour les filles ? Ces derniers temps, ces questions me revenaient souvent à l’esprit, restant sans réponse.
Je pensais à Hélène, et je pensais à Loïc, retrouvé depuis peu. Je me sentais si bien, en leur présence.
Une fois l’un, une fois l’autre. Sans doute, je me jouais d’eux, mais la peu de décevoir l’un ou l’autre me paralysait dans ma prise de décision. Le soir venu, seul dans mon lit, les angoisses, les doutes, l’amertume, et souvent la nostalgie, prenaient des proportions démesurées dans le noir.
Hélène, encore une fois, me sortit de ma réflexion :
- Je t’invite au cinéma, dit-elle, en me tendant le dernier Pariscope. Choisis un film. C’est toit qui décide, ce soir.
Un peu par provocation, je lui proposai « Philadelphia », avec Tom Hanks, un film grave sur l’amour entre deux hommes, avec le sida en toile de fond. Je me disais qu’après le fils, je pourrais aborder plus facilement le problème de l’homosexualité. Il fallait un élément détonateur, extérieur à nous-deux, pour déclencher une discussion.
Hélène accueilli ma proposition avec enthousiasme. Elle avait lu d’excellentes critiques sur ce film.
Après le film, je proposai à Hélène de la raccompagner. Après avoir remonté les Champs Elysée jusqu’à l’Arc de Triomphe, nous prîmes le métro direction Jaurès. Sitôt assise, Hélène m’indiqua, d’un mouvement de tête, deux garçons dont l’un était nettement maniéré, efféminé.
- Tu vois, Bertrand, j’ai déjà eu l’occasion de dîner avec un couple homosexuel, chez mon amie Stéphanie, et pourtant, je n’arrive pas à m’y faire.
- Tu ne m’en avais jamais parlé…
- C’était juste avant notre rencontre. Je ne te savais pas sensible à ce genre de sujets.
Du tac au tac, je répondis :
- Tu sais, faut pas croire, je suis un homme moderne, ouvert à tous les sujets, et d’une grande sensibilité, même je ne le montre pas toujours.
J’allais en rajouter encore, sur le mode un peu ironique, quand Hélène dit, poursuivant ses pensées :
- Cette soirée chez Stéphanie a été la pire de ma vie, je crois. Ils ne parlaient que de leurs sorties dans les bars gays et se faisaient, toutes les cinq secondes, des bisous dans le cou. Quelle tristesse !
Décontenancé, je ne trouvais plus grand chose à dire.
- Beaucoup d’entre eux vivent en circuit fermé, tu sais, en ghetto. Ils aiment faire la fête, danser jusqu’à l’aube, dans des endroits où ils rencontrent des tas d’amis.
Hélène avait la mine sombre.
- Hum, des amis…
Le métro arrivait à la station Jaurès. Je crus bon de dire, pour clore le sujet :
- Tu n’as sans doute pas rencontré le meilleur exemple. Tu sais, pour certains, tu ne t’apercevrais de rien, en les croisant dans la rue. Ils sont comme Monsieur Tout-le-Monde.
En moi-même, je rajoutait : ils sont comme moi.
Il y avait comme un voile sur le visage d’Hélène, quand je la quittai au pied de son immeuble.
Sur le chemin du retour, je fis une halte dans un bar du Marais, où je savais pouvoir retrouver d’anciennes connaissances. Et en effet, accoudé au comptoir, je reconnus Hervé, une chope de bière à demi vide devant lui. Il était vêtu d’un simple tee-shirt blanc, qui contrastait avec son pantalon sombre. L’ensemble soulignait un corps étonnamment fin, mais néanmoins musclé, sans un gramme de graisse. Il y avait plus de six mois que nous ne nous étions vus.
Après les banalités des retrouvailles, nous terminâmes la nuit ensemble, chez lui, comme si nous nous attendions l’un l’autre, ce soir-là.
Hervé vivait seul. Son dernier petit ami l’avait quitté trois semaines plus tôt. Il y avait incompatibilité d’humeur entre eux. Mais la tristesse se lisait sur le visage d’Hervé, et ses traits tirés exprimaient une réelle déception. Il me dit combien il était accablé de se retrouver, tous les soirs, face à une chaise vide, quand il rentrait du travail.
Il en est souvent ainsi des garçons : entourés de nombreux amis, mais seuls dans leur cœur. Aussi, afin d’éviter de sombrer dans les idées noires et le désespoir, beaucoup tentent la colocation, sans pour autant éprouver des sentiments pour le partenaire. Chacun vit sa vie de son côté, mais sans la solitude du quotidien, sûr de pouvoir trouver une épaule où poser sa tête en cas de difficultés passagères, même sentimentales. C’était le mode de vie d’Hervé, depuis que je le connaissais. Mais visiblement, son dernier colocataire lui avait tourné la tête.
Au moment de quitter Hervé, au petit matin, je crus bon de le rassurer :
- Je ne m’inquiète pas pour toi. Mignon comme tu es, tu retrouveras vite quelqu’un d’autre ! Et si tu as un coup de cafard, n’hésite pas, tu m’appelle, et je viendrai de réconforter.

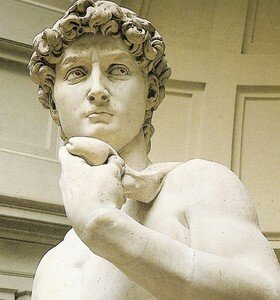


/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F7%2F173784.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F81%2F85%2F204521%2F7974426_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F84%2F21%2F204521%2F7840652_o.jpg)
/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F33%2F54%2F204521%2F7840509_o.jpg)